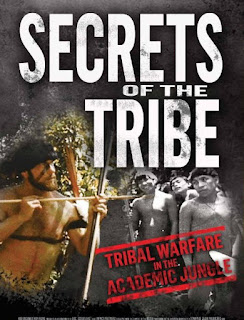Article publié en Janvier 2015 dans la revue AAARG #007
« Savez-vous
compter merdeux ? Je dis que l’avenir sera à nous si vous savez compter ! »
Ainsi parle Cyrus à des dizaines de marlous massés dans un parc du Bronx. Ainsi
commence Les Guerriers de la Nuit, un
de ces films qui représenta, entre Orange
Mécanique et Mad Max, ce qu’on appelait alors à la fin des années 1970 l’ultra violence. Depuis, les Warriors
courent toujours. Le film a aujourd’hui 35 ans, et même si sa brutalité semble désormais
bien timide en regard des standards actuels, il continue d’inspirer la culture
populaire : au cinéma (on peut par exemple voir l’affiche du film dans American Gigolo, mais également dans le
navrant Cyprien), à la télé (les Simpsons ou Robot Chicken y ont fait régulièrement référence) ou en musique (le
groupe de hardcore brésilien I shot Cyrus a fait sa carrière autour du film,
Method Man l’a samplé et Booba s’est déguisé en Baseball Fury pour un clip) et
jusque dans l’univers du jeu vidéo puisqu’il a inspiré le classique du beat
them all japonais Renegade et a
annoncé le cultissime Double Dragon.
Les gens qui ont eu La 5 de Berlusconi comme baby-sitter savent pourquoi il est
important de ne pas oublier ce film. Pour les autres, sachez que si on consacre
quelques pages à ces Guerriers de la nuit, c’est parce qu’ils se tiennent
discrètement dans chaque recoin de notre inconscient collectif, et qu’il est
temps de les honorer.
« Warriors,
la partie va commencer ! »
Luther
Luther
Cyrus, le chef des Riffs, la bande la plus puissante de New
York, convoque des émissaires de toutes les autres bandes de la ville à un
immense conclave dans le Bronx. Il exhorte alors la foule, évoquant un futur où
toutes les bandes unies pourraient contrôler la ville, mais se fait rapidement
abattre par le chef des Rogues, Luther. Une bande est accusée par erreur
d’avoir fait le coup, ce sont les Warriors. Le film est l’histoire de la
débâcle de cette nuit-là et de leur périple, mené par Swan. Sur la route qui
les ramène chez eux, à Coney Island, les bagarres avec les autres gangs et la
police vont se succéder. Finalement chez eux, au petit matin, ils retrouvent
les Rogues sur la plage. Le film se conclut par l’intervention des Riffs,
désormais au courant de l’identité des véritables assassins. Ils saluent respectueusement
le courage des Warriors et massacrent Luther et ses hommes.
« Le genre de bande
à laquelle appartenait mon père, c’était les communistes ! »
Sol Yurick
Sol Yurick
Pur produit des seventies, le film puise cependant ses
racines dans les années 1950 dont la réalité sociale a inspiré le roman Les Guerriers de la Nuit à Sol Yurick. Yurick
est né dans les années 1920, au sein d’une famille d’immigrants juifs,
politiquement très actifs. Il s’installe à New York et, après la guerre, s’engage
dans l’aide sociale, passant des années à fréquenter jeunes et familles en
difficulté. Il va alors étudier la délinquance juvénile et les structures parallèles
qui s’échafaudent sur cette misère : « Les gangs qui combattaient comprenaient des centaines de personnes,
c’étaient de véritables armées… »
En 1965, Yurick écrit donc Les Guerriers de la Nuit, une plaisanterie dit-il, rédigée en trois
courtes semaines. L’histoire, vaguement similaire au film, tourne autour d’un
groupe de très jeunes voyous qui cherchent avec leur bande à recréer une
structure autoritaire pour se protéger du chaos qui règne autour d’eux. Idiots
et désespérés, aussi méchants qu’immatures, les gamins du roman de Yurick se
débattent comme ils le peuvent dans un monde qui n’est pas à eux et qu’ils
cherchent à dominer. À travers une brutalité extrême, le gang leur permet de
reconstruire des rituels et une hiérarchie leur offrant un cadre pour affronter
la ville, les « Autres » et les gamins des blocs voisins. Le livre,
issu de l’expérience de Yurick sur le terrain, est une chronique des angoisses
de cette jeunesse new-yorkaise livrée à elle-même. Finalement, bien plus que
les autres gangs, ce sont leurs propres peurs, rationnelles ou pas, et leur
isolement social que les personnages vont passer la nuit à affronter. Proche
parfois d’un récit comme Sa Majesté des
mouches, il se dégage un désespoir profond de ces gamins qui passent leur
nuit à se persuader qu’ils sont des « Hommes » avant de s’endormir,
dans les dernières lignes du livre, épuisés et le pouce dans la bouche…
« Je me
souviens avoir été impressionné, Sol Yurick avait une telle charge politique
et puis Walter était ce type post-Peckinpah qui avait un côté cow-boy viril,
avec un code d’éthique et d’action… »
et puis Walter était ce type post-Peckinpah qui avait un côté cow-boy viril,
avec un code d’éthique et d’action… »
David Patrick Kelly « Luther »
1969, quelques années après sa publication, le producteur
Lawrence Gordon achète les droits du roman pour le compte d’AIP, une boîte de
production spécialisée dans la série B. David Shaber est engagé pour en écrire
le scénario. Gordon balance un jour le bouquin à son ami Walter Hill et lui
demande de le lire. Hill, futur réalisateur de 48 heures et qui à l’époque venait de réécrire le scénario d’Alien qu’il allait produire avec sa boîte,
apprécie la puissance du récit mais décline l’offre pensant que personne ne les
laisserait adapter un tel script. « C’était
trop extrême, trop bizarre » explique-t-il aujourd’hui, « Nous allions faire un western mais tout a
été annulé. [Gordon] m’a rappelé pour me demander si je voulais bien faire ce
truc de gangs parce qu’il pouvait toujours l’amener à la Paramount. »
Une semaine plus tard il est à New York pour débuter la préproduction du film.
Le deal avec la Paramount repose sur la promesse que le film
sera tourné rapidement et qu’il ne nécessitera qu’un budget réduit. Green-lighté en avril 1978, il sortira
effectivement moins d’un an plus tard, en février 1979. Un exploit, même si le
tournage a explosé le calendrier… « Une
des raisons de la brouille avec la Paramount, explique Hill, c’est qu’on a été en retard. On s’est
complètement trompés à ce niveau. Le film a été tourné durant l’été 78 et nous on
était des gars de Los Angeles, on n’a pas compris à quel point les nuits de New
York sont courtes durant l’été. De plus, à cette époque, les contrats
stipulaient que l’équipe avait une heure pour le repas, ça prenait un temps fou
pour tout réorganiser. Finalement on avait des journées de travail réduites de
moitié par rapport à un jour normal à Hollywood. En même temps on a travaillé
très rapidement et je pensais tout faire en 30 jours, mais on a été bien
au-delà… »
Ils vont également être confrontés aux difficultés inhérentes
à un tournage dans les rues de New York. À toute heure, même la nuit, ces
dernières restent peuplées de badauds qui se pressent autour du plateau et
gênent le tournage. Il y a aussi les véritables gangs de la ville qui ne
tardent pas à se manifester. Tout d’abord, ce sont les Homicides de Coney Island qui ne voient pas d’un
très bon œil qu’une autre bande, même fictive, occupe leur territoire. La
consigne est alors claire, aucun acteur ne doit se promener avec son costume en
dehors du plateau afin d’éviter toute provocation. Pour la scène du cimetière,
un grillage est dressé tout autour du plateau pour en assurer la sécurité et
empêcher les incursions. Nuit après nuit, l’ambiance va rester très tendue :
des loubards, déçus de ne pas avoir été choisis au casting, vont menacer de
mort les membres de la production ; certains attaqueront même le plateau,
tenteront des extorsions ou jetteront des briques pendant que d’autres
urineront sur l’équipe depuis un toit… Les
Mongrels, un gang local, sont engagés à prix fort pour protéger les camions
pendant que de véritables gardes du corps protègent les acteurs. Pour la scène du
conclave, des dizaines et des dizaines de figurants sont embauchés, dont de
nombreux membres de gangs. Chaque matin, pour arriver à récupérer les costumes,
la production met en place une tombola. Chaque figurant reçoit son costume au
début de la nuit et doit le rendre au petit matin. Lorsque le costume est
rendu, on offre en échange un ticket de tombola, et tous les matins, des lots
sont tirés au sort. Le système fonctionne quelques jours, jusqu’à ce qu’un
gagnant, quittant le plateau avec sa TV couleur, se fasse agresser par une
partie des jeunes. « De temps en
temps, des gars venaient nous brancher, ils nous demandaient si on pensait être
des durs… On répondait nan, on est juste des acteurs ! » raconte
Terry Michos, l’interprète de Vermin.
« Parfois, je me demandais si c’était un
film ou un marathon. »
Marcelino « Rembrandt » Sanchez
Marcelino « Rembrandt » Sanchez
Le 9 février 1979, le film sort aux États-Unis dans une
combinaison de 670 cinémas, porté par des critiques positives et notamment celle de Pauline Kael que la
Paramount décide d’utiliser comme argument publicitaire. Certaines critiques
moins positives, comme celle de Variety,
promettent que le film va être « une
réussite pour les foules bagarreuses ». Trois jours après la sortie,
le 12 février, un type se fait tuer dans une rixe qui éclate dans une salle. Le
15, à Boston, un affrontement entre bandes devant un cinéma projetant le film
provoque un nouveau décès. Le même soir, à Palm Strings, un autre gars se fait
tuer dans un drive-in… Rappelant la calamiteuse sortie anglaise d’Orange Mécanique, la rumeur enfle à
travers tout le pays que le film provoquerait le chaos partout où il serait
exploité. Des associations de citoyens, l’Église et d’autres groupes
d’influence organisent des manifestations hostiles au film. La Paramount
propose d’offrir un service de sécurité aux cinémas qui le souhaitent, et
annule une semaine plus tard la campagne d’affichage qui avait coûté 100 000 $.
En effet si, dans le film, la menace est tournée vers les gangs eux-mêmes
plutôt que vers le public, l’affiche, avec sa masse de jeunes faisant face aux
spectateurs et surtout sa tagline, est
accusée d’exciter les bagarreurs : « Voici
les armées de la nuit. Ils sont 100 000. Ils sont cinq fois plus nombreux que
tous les policiers de la ville. Ils pourraient diriger New York. » Les
nouvelles affiches sont blanches, simplement illustrées par le lettrage du
titre. Au même moment la bande annonce est censurée. Lorsque le narrateur
explique « qu’entre eux et la
sécurité se tiennent 20 000 policiers et 100 000 ennemis jurés » un
bip est placé sur « 20 000 »
et « 100 000 ».
En France, c’est encore pire, Les Guerriers de la Nuit fait partie de cette petite poignée de
films qui écopent, à la fin des années 1970, d’un classement X pour violence.
Malgré une tentative de passage en force grâce à une présentation au festival
de Deauville, le film est ixé par le pouvoir giscardien le 25 Juin 1979.
L’année suivante, CIC exploite une copie interdite aux moins de 18 ans,
tronquée d’une douzaine de scènes, provoquant la colère de Walter Hill étalée
dans une lettre publiée par l’Express.
Il faudra attendre 1984 pour que le film soit exploité intégralement, frappé ce
coup-ci d’une simple interdiction aux moins de 13 ans. En bout de course, il rapportera
22 millions de dollars, un succès mitigé…
De cette sortie chaotique, Les Guerriers de la Nuit garde une réputation d’ultra violence qui peut
aujourd’hui prêter à sourire. Un malentendu pour un film qui propose un
spectacle onirique aux antipodes de l’horreur sociale dépeinte par Yurick.
D’abord parce que le livre, à l’instar du roman L’Orange Mécanique ou de ce qu’on peut lire dans le scénario
original de Mad Max, traite d’une
bande de gamins âgés de seulement 14 à 17 ans. En mettant en scène de jeunes
adultes, Hill dégage une partie des considérations sociales et politiques inhérentes
à la représentation de la délinquance juvénile et recentre son récit autour de
l’action et de l’odyssée métaphorique qu’entreprend la bande de Coney Island. Et
si le film ne s’embarrasse pas d’une analyse sociale c’est surtout qu’il évolue
sur le terrain mythologique.
Chez Yurick, l’un des enfants lit une adaptation en
comic book de l’Anabase, écrit par
l’athénien Xénophon vers le quatrième siècle avant Jésus Christ. Il s’agit du
récit de la retraite de plus de 13 000 mercenaires grecs engagés par Cyrus le
Jeune pour rejoindre la Mésopotamie combattre son frère Artaxerxès II. Suite à
la mort de Cyrus et menés par Xénophon, les mercenaires ont dû fuir à travers
tout l’Empire perse, affrontant de nombreuses situations hostiles, jusqu’à ce
qu’ils parviennent à atteindre le détroit des Dardanelles et à incorporer
l’armée de Thibron. Métaphore offrant une dimension symbolique à l’aventure des
gamins et à leurs rêves d’héroïsme, l’Anabase
n’apparaît plus dans le film qu’en filigrane. Au-delà de l’intrigue basique et
de sa conclusion en bord de mer, il reste le nom du leader, Cyrus, dont la mort
provoquera la débandade et peut être la référence à la guerre de Troie avec le
nom du plus va-t-en-guerre de la troupe : Ajax. Pourtant, ce lien est à
l’origine de la structure sur laquelle Hill souhaite faire reposer son film. À
cause de la frilosité du studio, le film terminé est assez loin des intentions
initiales de son auteur. La critique américaine Paule Kael, qui trouvait que Les Guerriers de la Nuit aurait pu être
l’adaptation du comic book que le gamin du roman traîne avec lui, ne croit pas
si bien dire.
En effet, l’idée initiale de Hill était d’introduire le film
par un texte lu par Orson Welles qui aurait fait un pont entre l’odyssée des
Warriors à celle des mercenaires grecs. Il pensait également découper le film
en chapitres, introduits par des cartons dessinés. Il souhaitait aussi accentuer
le décalage fantaisiste de ce procédé en commençant par ces quelques mots « Plus tard, dans le futur ». « J’ai toujours cru que le film serait
incompréhensible sans ça, explique Hill,
j’ai toujours trouvé que c’était un film de science-fiction. » Une idée encore
une fois refusée par le studio qui craignait que ça ne sonne trop… Star Wars !
« - Qu’est-ce que tu penses
de Cyrus ?
- Magique, tout ce qu’il y a de magique… »
Cowboy & Cochise
- Magique, tout ce qu’il y a de magique… »
Cowboy & Cochise
Même ainsi, dépouillé de ces ambitions, le film de Hill reste
parcouru par une force mythologique évidente. Les gamins de Yurick qui jouent
aux soldats deviennent à l’écran l’élite d’un gang qui subira une série
d’épreuves quasi divines. De l’aura quasi légendaire qu’inspire Cyrus à l’épure
d’un cadre pratiquement abstrait où seuls les protagonistes semblent exister, Les Guerriers de la Nuit a construit son
culte sur une fascination qui dépasse de loin la trivialité de l’incident ici
narré. Dans le roman, les gamins évoluent au milieu d’une foule d’éducateurs
sociaux, de putes, de camés ou dans des métros bondés et leur rapport aux
Autres définit autant leur haine que leurs peurs et se vautrent dans une
violence laide, et dramatiquement bête. A
contrario, les Warriors du film de Hill traversent un monde fantasmagorique
où seules les autres bandes semblent exister et où la violence est
chorégraphiée.
Contrairement à bien d’autres films consacrés à la violence
qui règne dans la jungle urbaine, les
Guerriers de la Nuit ne dirige jamais son agressivité contre la population.
Ils sont les fantômes de la ville, ceux qui attendent la nuit pour venir hanter
les rues, révélés par la lumière crue des néons. Les Guerriers de la Nuit est un film surréaliste où la mise en
scène de ce que Kael appelle « la
colère des dépossédés » transforme l’espace urbain en zone
aussi mythique que cauchemardesque. Une mise en scène où des fantômes se
perdent dans un cadre et une photo servant, à leurs dépens, la beauté abstraite
de l’architecture. Une ambiance
également rythmée par une bande son divisée en deux idées. Les moments
synthétiques, ces moments où la lumière, lorsqu’elle bouge, semble se muer en
son, et des chansons rock à l’existence diégétique (c’est le DJ qui place les
morceaux écoutés par les gangs sur leurs transistors) et aux titres évocateurs
: Nowhere to run, In the City, You’re movin’ too
slow… Cette zone, au croisement de la réalité et de la mythologie,
disparaît lorsqu’enfin le jour se lève et qu’on a atteint le bout de la route.
L’onirisme des néons laisse place à une crasse réelle, froide, et le parcours
héroïque qui a permis aux braves de prouver leur courage à une désillusion
mélancolique.
« Les putes sont armées !
Les putes sont armées ! »
Rembrandt
La masculinité et la force dégagées par ce groupe d’hommes se
sont fracassées sur une réalité qu’ils ont refusé de voir. C’est Ajax qui se
fait piéger par la jeune fille qui est assise seule dans le parc et qui se
révèle être une policière. Ce sont les trois Warriors bernés par les Lizzies,
des sirènes qu’ils prenaient pour d’innocentes prostituées, comprenant trop
tard que leur docilité n’était qu’apparente. Et c’est surtout Swan dont
l’arrogance ne pourra rien devant Mercy, la fille qui va s’attacher à eux et
les suivre jusqu’au bout. Faire-valoir et simple objet sexuel, Mercy s’extirpe pourtant
du cadre limité offert aux personnages féminins dans ce genre de productions en
revendiquant son autonomie et en justifiant ses choix. Dans sa volonté de
prendre son destin en main, elle rappelle le personnage de Fray, dans le Zombie de Romero sorti l’année
précédente. Face à Mercy, le caractère dominant de Swan se transforme en
posture vaine et le confronte à son propre conservatisme moral.
35 ans plus tard, le cauchemar des Warriors continue de hanter la mémoire des cinéphiles. Il y a dix ans, on a pu constater que le culte du film n’avait jamais cessé. Rockstar a édité un jeu vidéo au succès critique et populaire indéniable. Dans la foulée, un DVD proposant un director’s cut s’est vendu comme des petits pains. 25 ans après la sortie, Hill a enfin eu toute latitude pour insérer ses plans de bandes dessinées et son prologue, au grand dam des amoureux du film qui voient à travers ce bidouillage douteux une véritable trahison. En attendant une réédition digne de ce nom, le film semble ne pas vouloir se laisser oublier. Les rames de ce cauchemar nocturne continuent de prendre des voyageurs qui n’ont pas fini de se réveiller dans le sordide et la crasse. Aujourd’hui, intemporel car dégagé de son époque, le film a rejoint sa propre mythologie et les empreintes de ses guerriers vont continuer de courir à travers toute la culture populaire…
« - Dire que c’est
pour trouver ça que toute la nuit on s’est battus… Je vais mettre les voiles,
ici c’est trop moche.
- Moi aussi tu sais j’aime voyager…
- T’es déjà allée dans quel bled ?
- J’ai mis les pieds nulle part, mais je sais que j’aimerai ça. »
- Moi aussi tu sais j’aime voyager…
- T’es déjà allée dans quel bled ?
- J’ai mis les pieds nulle part, mais je sais que j’aimerai ça. »
Swan & Mercy