Article publié en Janvier 2014 dans la revue AAARG #002
Eli Roth, réalisateur d’Hostel et inoubliable Ours Juif d’Inglorious Basterds, a toujours été un
fan absolu de Cannibal Holocaust. À
tel point qu’il avait invité son auteur, Ruggero Deodato, à tenir un petit
caméo dans Hostel 2 et qu’il revient
aujourd’hui à la réalisation avec The
Green Inferno. Entre l’hommage et la relecture du chef-d’œuvre du film de
cannibales, Eli Roth ranime à la surprise générale un genre tombé en désuétude
depuis une bonne vingtaine d’années et qui n’aura laissé qu’une trace peu
flatteuse dans l’histoire du cinéma. C’est pourtant de ce genre mineur et
méprisé qu’a émergé en 1980 l’un des classiques les plus dérangeants du cinéma
d’horreur. À l’époque où s’enchaînaient les films brutaux qui ne rigolaient pas
(Zombie, Maniac), et avant que le genre ne tourne au postmodernisme
rigolard, Cannibal Holocaust a choqué
une génération de cinéphiles, figeant d’horreur la censure. Aujourd’hui, il
suffit d’aller fureter sur internet pour voir que les légendes qui entourent le
film sont toujours vivaces et que la provocation qu’il exhale n’a rien perdu de
sa force, plus de 30 ans après sa création. Alors pendant qu’Eli Roth répand
les viscères de ses étudiants idéalistes et s’applique à repeindre en rouge
l’enfer vert, revenons quelques instants sur le film de Deodato pour tenter de
comprendre pourquoi il continue d’interroger son public, pourquoi l’impact de
sa violence ne s’est jamais altéré, et pourquoi il se refuse encore aujourd’hui
à se faire oublier en disparaissant discrètement dans les mémoires de quelques
cinéphiles avertis. Toujours d’actualité, toujours aussi fort, le film de
Deodato semble ne jamais vouloir vieillir.
Cannibal Holocaust raconte le voyage d’un anthropologue
américain, le professeur Monroe, parti à la recherche d’une équipe de
journalistes disparue au cœur de la forêt vierge amazonienne. Agissant avec
respect, il gagne la confiance d’une tribu et parvient à récupérer les bobines
de films appartenant aux disparus que les Indiens conservaient comme totem. Le
visionnage de ces images brutes constituera la seconde partie du film où l’on
va découvrir les journalistes s’adonner à tous les excès pour obtenir des
scoops, allant jusqu’à violer et tuer des Indiens, jusqu’au dernier moment où
la caméra enregistre leur destin funeste.
« Mon cher
Ruggero, quel film ! La seconde partie est un chef-d’œuvre de réalisme
cinématographique…
Tout semble si réel, je crois que tu vas avoir de gros ennuis. »
Sergio LEONE
Tout semble si réel, je crois que tu vas avoir de gros ennuis. »
Sergio LEONE
Dire que le film a connu des soucis avec la justice est un
doux euphémisme. Conséquences des rumeurs de snuff entretenues par la
production à des fins commerciales, la tête de Deodato est mise à prix en
Colombie et la justice italienne va le persécuter plusieurs années pour
finalement le condamner à une amende et à une peine de prison avec sursis. Le
film va connaître l’interdiction ou la censure dans plus d’une soixantaine de
pays et pourtant, c’est un succès commercial prodigieux. Partout où il est
projeté, censuré ou non, c’est un tabac et l’exploitation vidéo prenant le
relais fera de Cannibal Holocaust un
véritable film culte.
Cannibal Holocaust reprend les conventions du récit
d’exploration classique, avec son groupe d’explorateurs blancs tombant dans les
mains de sauvages et des poncifs qui en découlent (la scène du repas dégoûtant que
le Blanc est obligé de partager avec les Indiens) pour les diluer dans
l’approche néoréaliste héritée de Rossellini et du mondo. Deodato a beau clamer
partout que son film a été tourné avec de véritables cannibales, sur les lieux
mêmes où ils vivent, en sous-entendant que les décors sont réels ou qu’ils ont
été reconstruits fidèlement, il n’en est rien. Les Indiens Yanomamis (appelés
dans le film Yamamomos, et dans les
articles qui lui sont consacrés, avec toutes les déclinaisons possibles que les
fautes de frappe et le j’men-foutisme permettent) sont loin de ce qui nous est
présenté dans le film. S’ils se livrent à l’occasion à l’endocannibalisme (ils
consomment les os broyés de leurs morts), ils ne pratiquent absolument pas
l’excocannibalisme agressif qu’on trouve dans le film. Les Yanomamis ont été
découverts quelques décennies plus tôt, et depuis les années 1950 ils sont
constamment visités par des anthropologues, soumis
à toutes les études possibles, et deviennent à cette époque un sujet de
discordes universitaires sans fin. Dans les années 1970, ces Indiens vont
devenir à la mode et les stars du showbiz comme Sting s’investissent dans la
défense de leur mode de vie, surfant sur le mythe du Bon Sauvage. L’Homme
naitrait bon avant que la société ne le corrompe. Ainsi, l’Homme préservé de
toute civilisation incarne une idée de pureté originelle. Cette idée est
balayée par un anthropologue, Napoléon Chagnon, qui publie en 1968 le livre Yanomami
le peuple féroce, dans lequel il fait le portrait d’une civilisation en guerre
perpétuelle. Illustrant cette thèse, et piétinant l’idéalisme béat du
professeur Monroe et d’une partie du public, Cannibal Holocaust ne présente pas
de bons sauvages ; il met en scène des gens vivant dans un milieu rude, de
manière brutale et aux rites difficilement déchiffrables. Même si les rituels
sont fantaisistes et que les Indiens ne sont pas présentés sous un jour très
positif, ils restent en dehors de toute réinterprétation romantique. La nudité
n’est plus l’expression d’un érotisme sauvage émoustillant l’explorateur et
invitant l’exploratrice à se dénuder dans une communion hippie des corps et de
la nature. Lorsque le film se tourne vers le sexe, c’est par le viol d’une Indienne
qu’il le fait. Il rejoint ainsi parfaitement le cinéma d’horreur
américain de cette époque qui taillait en pièces le rêve hippie.
Yanomamis, une guerre d'anthropologue. De José Padilha.
(un documentaire édifiant et passionnant sur notre vision des indiens Yanomamis)
(un documentaire édifiant et passionnant sur notre vision des indiens Yanomamis)
Retournant les valeurs et les attentes des spectateurs, il
n’est pas question ici d’opposer la civilisation à la sauvagerie mais de
montrer que la sauvagerie n’a pas quitté le civilisé. Un nihilisme qui éloigne
le film d’une vision raciste ou idéaliste de l’Autre en mettant en avant la
brutalité de l’Homme, quel qu’il soit, en sous-entendant qu’il naît mauvais et
que la société le déprave. La jungle n’est pas le lieu de l’innocence et la
démarche de Cannibal Holocaust
prolonge ici le travail de Werner Herzog : « C'est la nature elle-même que nous défions » explique-t-il, « Et elle nous rend coup pour coup, elle se défend, voilà tout. Elle est
grandiose et il faut accepter le fait qu'elle soit plus forte que nous. Kinski
dit toujours qu'elle regorge d'éléments érotiques. Moi je la trouve plutôt...
pleine d'obscénité. La nature ici est assez ignoble et vicieuse. Je n'y vois pas
d'érotisme, j'y verrais plutôt la fornication, l'asphyxie et l'étouffement, le
combat pour la survie, la croissance... Et la pourriture. Bien sûr, elle est
pleine de souffrance, mais c'est la même qu'on voit partout. Ici les arbres
souffrent, les oiseaux aussi. Ils ne chantent pas, ils crient plutôt leur
douleur. En regardant bien autour de nous on constate une certaine harmonie.
L'harmonie du meurtre, omniprésent et collectif... »
« Oh, good
Lord! It's unbelievable. It's...
it's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. »
Cannibal Holocaust s’ouvre sur un carton : « Pour l’authenticité certaines scènes sont
intégrales. » Ça ne signifie pas grand-chose mais le ton péremptoire
prévient le spectateur que ce qu’il va voir est authentique. Un procédé alors moins commun qu’aujourd’hui (où le « inspiré d’une histoire vraie » ne
trompe plus personne) et renforcé par des images aériennes de l’Amazonie
montrant l’isolement total du décor du film. Le spectateur est prévenu, we’re not in Kansas anymore ! Le
film débute comme un reportage télévisé avec un journaliste qui parle directement
au spectateur. Son image est intercalée dans des prises de vues de New York,
puis visible d’une rue où on le retrouve évoquant l’expédition amazonienne de
Yates et de ses acolytes à travers des télévisions alignées dans une boutique,
sous l’œil curieux des badauds. L’image zoome et dézoome, passant d’une réalité
à l’autre, pour finalement basculer définitivement en Amazonie. À l’image, le
spectateur est transporté dans le documentaire, alors qu’il abandonne la
réalité new yorkaise pour investir le champ de la fiction amazonienne de
l’expédition du professeur Monroe.
Avant de basculer sur la seconde partie, le professeur est
invité à commenter les images des journalistes. Mais pour lui faire comprendre
qui ils étaient, la responsable de la chaîne de télé lui présente une série
d’images d’exécutions, de foules déplacées et de cadavres empilés, qu’ils
auraient tournées au Vietnam et au Nigéria…
Ce film, Last Road to Hell,
est un véritable flashforward de ce que les spectateurs verront par la suite.
Lorsque la directrice des programmes explique que tout a été mis en scène par
des soldats payés par l’équipe, c’est le début de la critique, assez grossière,
du voyeurisme et des moyens de fournir ce genre d’images ; mais il s’agit surtout
d’introduire le véritable enjeu de
Cannibal Holocaust : la manipulation par l’image. Car ce petit film
défini comme truqué a été créé par Deodato à partir d’atrocités réelles, issues
de véritables documentaires. Lorsque la seconde partie débute, il s’agit de
visionner les rushs des journalistes présentés sous le titre The Green inferno. Le film va reproduire le même dispositif que
pour Last Road to Hell, faisant des
allers-retours entre l’image et le contrechamp du professeur et des
responsables de la chaîne, créant une analogie évidente pour le spectateur dont
les repères commencent à être pour le moins brouillés.
La première partie, tout à fait classique, laisse donc place
aux rushs des journalistes dévorés. Subitement, le film change de réalisation,
les plans en 35 mm cèdent à un 16 mm granuleux tourné à la caméra à l’épaule.
Le jeu des acteurs est beaucoup plus naturel et l’image qu’on voit est celle tournée
par l’équipe, sans montage, avec les ruptures que cela entraine, aussi bien
visuelles que sonores. Ce principe, alors pratiquement inédit, a été repris et
popularisé par des films comme Le Projet
Blair Witch ou C’est arrivé près de
chez vous, devenant récemment une véritable mode et un genre en soi. Il ne
s’agit donc plus de nous raconter ce
qui s’est vraiment passé, mais de nous le montrer, pour de vrai.
« Today people want sensationalism;
the more you rape their senses the happier they are. »
the more you rape their senses the happier they are. »
Après avoir vu des images froides d’exécutions au Nigéria, le
spectateur se demande ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Rapidement, il va
être mis à l’épreuve. Une série de mises à mort non simulées d’animaux se
succèdent à l’écran. Une tortue est tuée puis mise en pièces pour être mangée,
un singe est décapité par les Indiens qui consomment sa cervelle. Au milieu de
ces scènes impressionnantes se glisse celle de Felipe, le guide, qui se fait
mordre par un serpent. Les journalistes lui tranchent la jambe. La caméra
capture l’évènement sur le vif. Il s’agit bien sûr d’un effet spécial, mais
pris entre deux scènes dont la brutale et choquante réalité ne peut être
discutée, l’illusion créée par cette mise en rapport est troublante, aussi puissante
que dérangeante. Cette série de scènes ayant servi de transition, celles qui
vont suivre abandonnent le snuff animalier pour étaler les multiples outrages
et mutilations que va subir l’équipe en représailles de leur attitude
criminelle.
Entre les rushs, se joue devant nous le sketch de la censure
à venir. La directrice veut que le film soit diffusé, mais Monroe déclare que
c’est outrageant et qu’il faut le détruire. Ce qui reviendrait à mentir par
omission au public qui pensera que les reporters ont été gratuitement exécutés
par des sauvages. Censurer le film pour des raisons morales conduit ainsi à une
injustice, une question d’autant plus intéressante que les atrocités filmées
rappellent celles des nazis ou des américains (renvoyant au village en feu du Vieux Fusil tourné quelques années avant,
ou aux massacres de Mỹ Lai au Vietnam).
On est ainsi interrogé sur nos motivations d’être témoin d’un « spectacle »
qui est condamné par le personnage auquel on est censé s’identifier et qui
représente le repère moral du film. La critique intradiégétique des actes des
journalistes rejoint également, de manière étonnante, les accusations contre
les méthodes de Deodato. Si les allégations de meurtres sont évidemment
fallacieuses, les conditions radicales du tournage ont souvent mis en danger
les membres de l’équipe, partagés entre l’euphorie de l’aventure et la plus
grande irresponsabilité, virant pour certains au cauchemar. Ainsi, lorsque des
animaux commencent à être tués devant la caméra, l’hystérie du tournage effraie
tellement l’un des acteurs, Gabriel Yorke, que ce dernier décide de garder en
permanence sur lui son passeport et son argent, prêt à fuir à tout moment.
« Here
we are at the edge of the world of human history.
Things like this happen all the time in the jungle;
it's survival of the fittest!
In the jungle, it's the daily violence of the strong overcoming the weak! »
Things like this happen all the time in the jungle;
it's survival of the fittest!
In the jungle, it's the daily violence of the strong overcoming the weak! »
Cette perméabilité entre la réalité et la fiction est aussi astucieusement
utilisée par Deodato qui commente en direct son film à travers la bouche de ses
personnages : « Continue de
tourner, on aura un Oscar pour ça » ou « Nous parlons du documentaire le plus sensationnel qui ait été fait
depuis des années… » Et quand le professeur Monroe juge ce qu’il a vu
en ces termes : « Ce pseudo-documentaire
est offensant, malhonnête et par-dessus tout inhumain », il anticipe
les critiques qui lui seront faites. Des critiques évidentes, mais qui manquent
leur cible étant donné que le film est conscient de sa propre malhonnêteté, et
que la mise en scène de cette malhonnêteté est le véritable sujet du film. Ainsi,
dans sa façon d’interroger le spectateur et de le mettre face à ses
responsabilités, Cannibal Holocaust entretient
des liens thématiques évidents avec
Orange Mécanique de Kubrick. Outre le discours sur le processus de
civilisation ayant échoué à extirper la sauvagerie de l’Homme, il est difficile
de ne pas penser au traitement Ludovico lorsque les membres de la chaîne de télé
sont dans leur salle de projection, consternés par ce qu’ils voient. Ultime
pirouette, The Green Inferno terminé,
on reprend le cours normal du film, réintégrant un 35 mm confortable, jusqu’à
ce que l’épilogue annonce que finalement l’appât du gain et le cynisme ont
triomphé : les négatifs n’ont pas été brûlés, mais volés et vendus une
fortune par l'un des techniciens de la chaîne. La raison de cet acte cynique
rejoignant la motivation même du film de Deodato : le profit.
Souvent sommairement présenté, le discours du film est résumé
en cet oxymore : Cannibal Holocaust
condamne la démarche raciste et brutale des journalistes (et, par ce biais, des
mondos) et le sensationnalisme des producteurs en usant des mêmes méthodes avec
au bout, la même cupidité. La volonté de dénonciation de Deodato lui serait
venue de son fils de 8 ans qui, durant les années de plomb italiennes, se
serait plaint de la violence déversée à la télé. Cette vision tronquée du film
rate l’essentiel. Cannibal Holocaust ne
dénonce pas par l’image, c’est un film qui étudie la puissance de l’image,
discute de sa véracité et provoque le spectateur à s’interroger sur ce qu’il
voit, tout en se basant sur une intrigue extrêmement morale, puisqu’il s’agit
ici de la réussite d’une expédition menée sur l’échange, rétablissant un ordre
chamboulé, et de la punition d’une autre reposant sur la terreur, le vol et
l’agression.
« I wonder who the real cannibals are. »
Au-delà du nihilisme du propos, Cannibal Holocaust reste un film complexe et ambigu, qui refuse
obstinément d’être ce qu’on voudrait qu’il soit. Choquant par son approche
radicale, on aimerait tellement qu’il se laisse dompter et finisse par
docilement livrer un discours manichéen sur des évidences. Le film de Deodato demeure
ainsi l’une des œuvres les plus fortes de cette époque. Une œuvre sans
descendance, car malgré un projet qui n’a jamais vu le jour (Cannibal Fury) et bien que les derniers
avatars du cannibal movie (Schiave
bianche, Natura contro, Mangiati vivi ! ou Nella terra dei cannibali) furent
frauduleusement retitrés Cannibal
Holocaust 2, le film de Deodato n’a jamais connu de suite officielle.
Récemment, le film Welcome to the jungle
fut considéré, à tort, comme un remake déguisé bien qu’il s’agisse plutôt d’une
suite officieuse mais astucieuse d’Ultimo
Mondo Cannibale. Il semblait donc que la page était définitivement tournée.
Pourtant, il y a quelques années, Deodato a mis en chantier une suite à son
film sous le titre Cannibals. Le
décor évoluant de la jungle amazonienne aux favelas de Bornéo. Un temps
disponible sur internet, le résumé du film laissait présager une prolongation
thématique saisissante sur le pouvoir et le sens de l’image. S’articulant autour
d’un récit hyper violent, il substitue l’Indien sauvage aux laissés pour compte
de la société moderne. Une idée exaltante que la sortie du film d’Eli Roth
permettra peut-être d’exhumer des cartons dans lesquels le projet semble
aujourd’hui oublié.







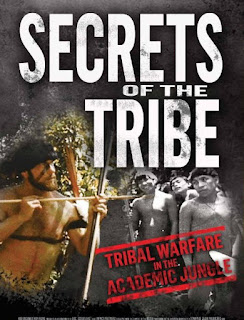








Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire